Droits d’inscription impayés pour le 1er février : quel recours ?
Pour rappel, chaque étudiant doit en principe payer le solde de ses droits d’inscription pour le 1er février au plus tard. Que se passe-t-il dans le cas contraire ? On fait le point dans cet article.
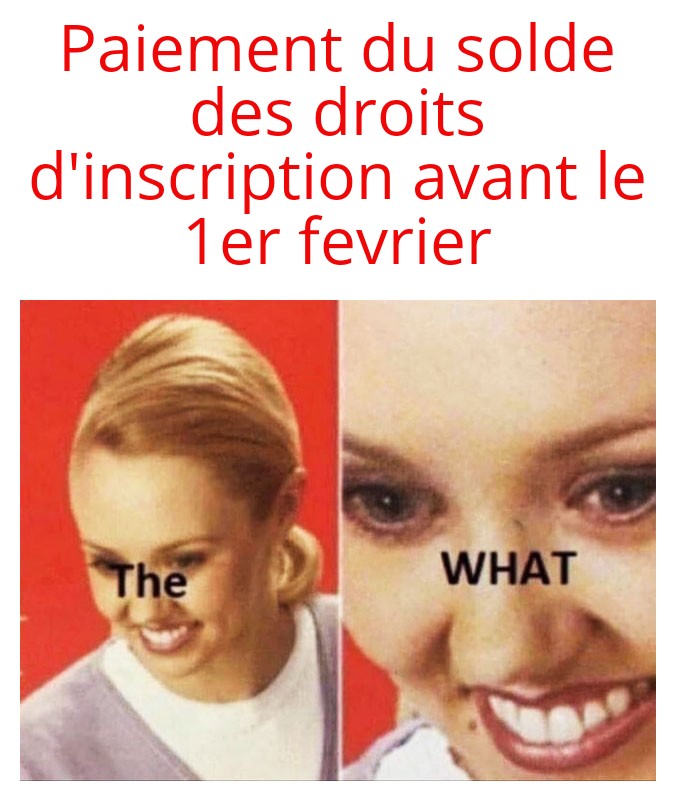
Droits d’inscription impayés : quelle est la règle et qui est concerné ?
Les étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur doivent payer le solde des droits d’inscription au plus tard pour le premier février de l’année académique concernée. Cette règle ne concerne pas l’enseignement de promotion sociale mais bien celui en Université, en Haute École et en Écoles supérieure des Arts. De même, cela concerne également les droits d’inscription spécifiques qui concernent certains étudiants ressortissants d’un pays tiers à l’Union européenne.
Quels sont les montants qui sont concernés?
Il s’agit des droits d’inscription. Quel que soit le montant.
Droits d’inscription impayés: Quelles conséquences?
À partir du 10 février, tu recevras une décision de leur établissement d’enseignement supérieur aux conséquences lourdes :
- Tu n’auras plus le droit d’accéder aux cours, travaux pratiques, examens ou autres activités académiques ;
- Tu seras considéré comme étant en échec pour toutes les activités d’apprentissage ou unités d’enseignement que tu aurais réussies au cours de l’année académique concernée. Tu seras considéré comme n’ayant acquis aucun crédit lors de cette année.
- Tu seras néanmoins considéré comme ayant été inscrit. Cela peut donc avoir un impact sur ta finançabilité ;
- Et tu resteras redevable des droits d’inscription de l’année académique concernée. Tu auras donc une dette.
Impact sur une future inscription
À défaut de les avoir payés, l’établissement ne délivrera pas d’attestation d’apurement de dette. Il s’agit d’un document nécessaire pour se réinscrire dans l’enseignement supérieur en Communauté française. Cette dernière règle ne concerne pas l’enseignement de promotion sociale. Outre l’impossibilité de se réinscrire, ce montant restera dû au même titre que n’importe quelle dette. Celle-ci pourrait être réclamée par voie judiciaire pendant un délai de cinq ans, hors interruption ou suspension de la prescription. En pratique, les établissements d’enseignement supérieur ne recourent pour le moment pas à la voie judiciaire.
Est-ce que l’établissement d’enseignement supérieur peut ne pas réclamer ce montant ?
Non. L’établissement d’enseignement supérieur est obligé de réclamer le paiement des droits d’inscription.
Existe-t-il des exceptions à cette date du 1er février ?
Oui, deux exceptions permettent à l’étudiant de bénéficier d’un délai supplémentaire.
Demande de bourse
D’une part, les étudiants qui ont introduit une demande de bourse (allocation d’études) ne doivent rien payer tant qu’ils n’ont pas reçu de réponse à cette demande. De même, tu ne devras rien payer non plus si ta demande de bourse a été acceptée. Mieux, tu pourras te faire rembourser l’acompte d’au moins 50 € que tu as éventuellement versé avant le 31 octobre. A contrario, un étudiant dont la demande de bourse a été refusée devra payer le solde des droits d’inscription. Dans ce cas, tu disposes d’un délai supplémentaire de 30 jours calendrier à partir du premier jour qui suit la date de la réception de cette décision de refus. À cet égard, introduire un recours contre la décision de refus ne permet pas de prolonger ce délai de 30 jours.
Cas de force majeure
D’autre part, les étudiants qui peuvent se prévaloir d’un cas de force majeure peuvent disposer d’un délai supplémentaire. C’est l’établissement d’enseignement supérieur qui détermine la notion de force majeure. Bien souvent, l’étudiant devra introduire le recours abordé au paragraphe suivant.
Comment contester la décision ?
Dans quel délai ?
À compter de la date de notification de la décision, l’étudiant dispose de 15 jours ouvrables pour la contester. Les jours ouvrables sont tous les jours de la semaine à l’exception du samedi, du dimanche et des jours fériés. Par ailleurs, le délai commence à courir le premier jour ouvrable qui suit la date de réception de la décision. Lorsqu’il s’agit d’un recommandé, la date de réception sera, en principe, celle à laquelle la personne se fait remettre le courrier recommandé.
Par courrier recommandé ou par courrier électronique ?
Les deux sont possibles. Toutefois, le courrier électronique (email) est préférable pour deux raisons. La première est que les destinataires de ce recours préfèrent traiter des courriers électroniques. La deuxième est que le courrier électronique peut être envoyé le dernier jour ouvrable après l’heure de fermeture du dernier point poste.
Que faut-il indiquer dans le recours ?
Le recours sera irrecevable si tu n’indiques pas les informations suivantes :
- Tes prénom(s), nom(s), adresse postale, numéro de téléphone, ton adresse électronique (email) ainsi que ta nationalité ;
- Une copie de la décision de refus qui indique de manière lisible la date d’envoi (enveloppe ou capture d’écran en cas d’envoi par courrier électronique) ;
- La dénomination légale de l’établissement d’enseignement supérieur à l’origine de la décision querellée ;
- Les études qui ont fait l’objet de la demande d’admission ou d’inscription;
- L’objet précis de recours + les arguments qui justifient le non-paiement des droits d’inscription.
- Ta signature ou celle de ton avocat ;
Quels arguments « fonctionnent » ?
Le destinataire du recours apprécie les arguments de façon totalement discrétionnaire. Il s’agira du Commissaire ou du délégué du Gouvernement compétent et nous en dirons un mot un peu plus loin. Néanmoins, deux situations conduisent généralement à ce que le recours aboutisse :
1. Demande de bourse
Lorsque l’étudiant a introduit une demande de bourse (allocation d’études). Dans ce cas, il devra en fournir la preuve dans le recours ;
2. Droits payés après le 1er février
Lorsque l‘étudiant a payé ses droits d’inscription entre le 1er février et le moment où il introduit le recours. Ici aussi, il devra en fournir la preuve dans le recours. En cas de preuve de paiement par virement, il faudra joindre une copie de l’extrait de compte qui indique le virement et non l’ordre de virement. Dans ce cas, l’étudiant devra également expliquer pourquoi il a payé en retard.
Souvent, on remarque une certaine marge de tolérance lorsqu’il s’agit de la première inscription de l’étudiant dans l’enseignement supérieur. Dans tous les autres cas, les commissaires et délégués du gouvernement font jusqu’à présent preuve de bienveillance pour peu que des circonstances sincères, véritables et attestées soient jointes au recours. Cependant, rappelons que chaque situation est alors appréciée au cas par cas.
À qui le recours doit-il être envoyé ?
Au commissaire ou au délégué du Gouvernement compétent pour ton établissement d’enseignement supérieur. À cet égard, la liste et les adresses électroniques sont disponibles ci-après :
- Haute École : cliquer ici
- Université : cliquer ici
- École supérieure des Arts :cliquer ici
Modèle de recours
Nous avons rédigé un modèle de recours qui est disponible ici.
Décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, art. 102, §1er.
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2015 fixant la procédure applicable aux recours visés aux articles 95 et 102 et à l’avis visé à l’article 97 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études.